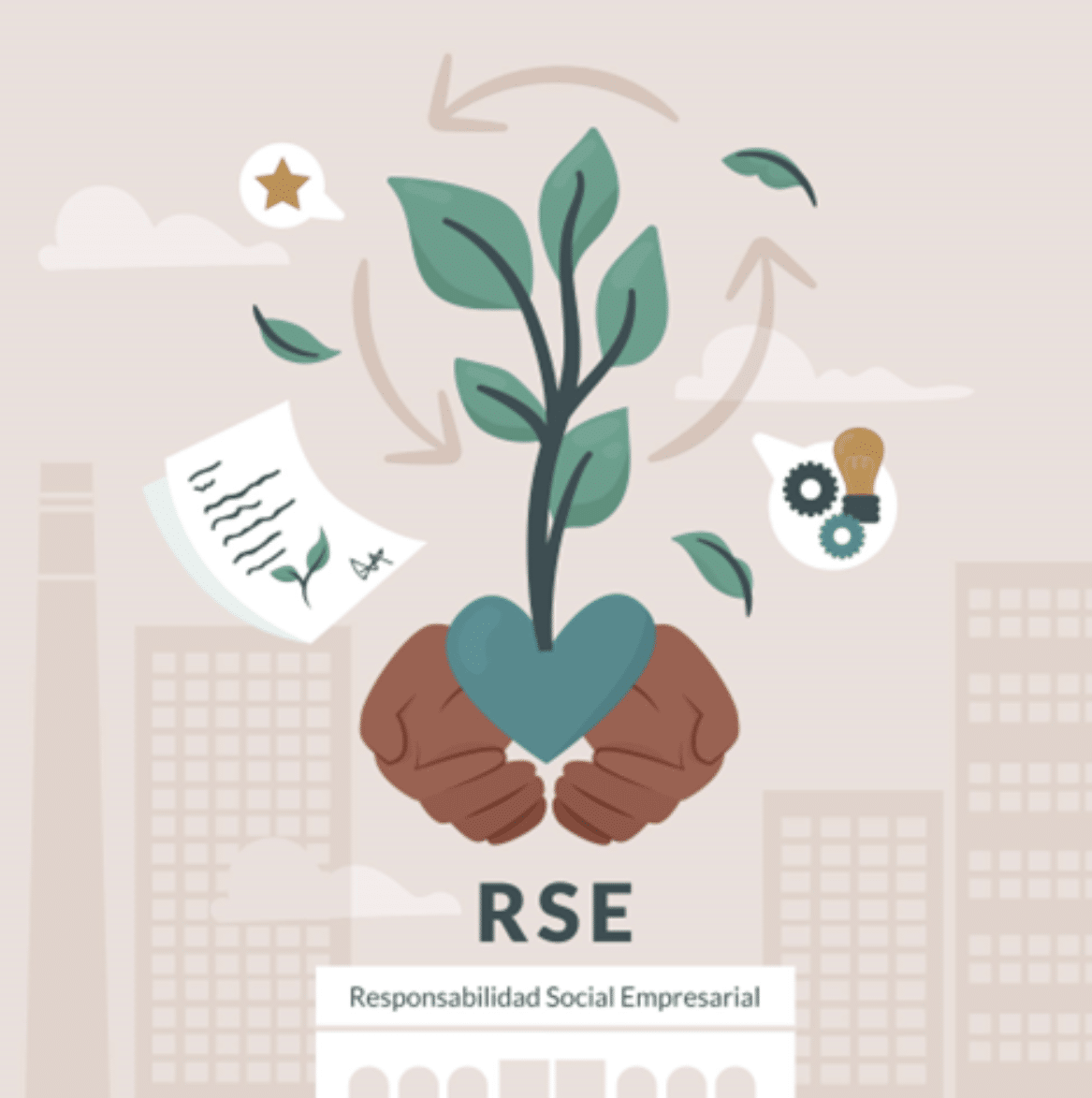La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) s’impose de plus en plus comme un pilier incontournable de la stratégie des entreprises. Loin d’être un simple affichage, elle recouvre l’ensemble des engagements environnementaux, sociaux, éthiques et sociétaux pris par les organisations. À l’horizon 2026, plusieurs grandes tendances RSE se dessinent. Elles reflètent à la fois l’urgence des défis planétaires et les attentes grandissantes des parties prenantes (clients, salariés, investisseurs, citoyens). Dans un langage clair et accessible, explorons les évolutions majeures attendues en matière de RSE d’ici 2026, autour de quatre axes : l’environnement, le social, la gouvernance et les attentes sociétales.
Environnement : décarbonation accélérée et protection de la biodiversité
La lutte contre le changement climatique reste au premier plan des priorités RSE en 2026. Les entreprises intensifient leurs efforts de décarbonation, c’est-à-dire de réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Beaucoup se sont fixé des objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050, avec des étapes intermédiaires dès 2030. Concrètement, cela se traduit par des investissements massifs dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la transformation des processus industriels. Par exemple, de grandes firmes mondiales comme Google ou Microsoft s’engagent à utiliser une électricité 100 % verte et à compenser ou éliminer le carbone résiduel de leurs activités. En Europe, les nouvelles réglementations climatiques (telles que le plan Fit for 55 de l’UE) renforcent cette dynamique en fixant des cibles de réduction plus ambitieuses pour les entreprises.
Mais en 2026, l’attention ne se porte plus uniquement sur le carbone. La préservation de la biodiversité émerge comme un enjeu majeur, au même titre que le climat. Les entreprises sont de plus en plus conscientes de leur dépendance vis-à-vis des écosystèmes (matières premières, services écosystémiques) et des risques associés à leur érosion. Suite à l’Accord de Montréal sur la biodiversité (COP15) adopté fin 2022, qui vise à protéger 30 % des terres et océans d’ici 2030, nombre d’entreprises élaborent des plans d’action pour réduire leur impact sur la nature. Cela passe par la protection des zones naturelles autour de leurs sites, le soutien à des projets de reforestation ou encore le passage à des pratiques agricoles régénératrices dans leurs chaînes d’approvisionnement. On voit également se généraliser des initiatives de “zéro déforestation” et d’achats responsables de matières premières (bois, papier, huile de palme, etc.), afin de préserver les forêts et la biodiversité.
En parallèle, l’économie circulaire continue de gagner du terrain. Le modèle du « produire-consommer-jeter » fait place à des pratiques plus durables : réduction des déchets à la source, recyclage, réemploi et allongement de la durée de vie des produits. D’ici 2026, davantage d’entreprises supprimeront les plastiques à usage unique de leurs emballages et proposeront des programmes de reprise et reconditionnement de leurs produits.
Passez à l’action : téléchargez notre guide décarbonation
La décarbonation est essentielle, mais complexe ? Simplifiez-vous la tâche.
Au programme : obligations, diagnostic carbone, stratégie, plan d’action, financements.

Social : inclusion, bien-être au travail et égalité des chances
Le pilier social de la RSE prendra en 2026 une importance accrue, avec un accent mis sur l’inclusion et le respect de chaque collaborateur. Les entreprises vont au-delà des discours et mettent en place des actions concrètes pour promouvoir la diversité au sein de leurs équipes. Il s’agit d’assurer l’égalité des chances quel que soit le genre, l’origine, l’âge ou le handicap. Par exemple, de plus en plus d’entreprises adoptent des plans d’actions pour féminiser leurs instances dirigeantes et réduire les écarts de salaires entre les femmes et les hommes.
En France, la loi impose déjà aux grandes entreprises de publier un index mesurant l’égalité professionnelle, et la pression monte pour améliorer ces scores chaque année. Les politiques d’inclusion visent également à mieux intégrer les personnes en situation de handicap (via le recrutement dédié ou l’aménagement de postes de travail) et à valoriser la diversité des parcours.
Les conditions de travail et le bien-être des employés seront aussi au centre des préoccupations RSE.
La crise sanitaire a transformé les modes de travail, rendant le télétravail et le mode hybride monnaie courante, mais soulevant de nouveaux défis en termes de cohésion d’équipe et de droit à la déconnexion. En 2026, les entreprises renforceront leurs initiatives de qualité de vie au travail : horaires de travail flexibles, programmes de soutien à la santé mentale, prévention du burnout, encouragement de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, etc. Certaines expérimentent même la semaine de 4 jours sans perte de salaire, dans l’objectif d’améliorer la productivité tout en réduisant le stress des employés. L’idée sous-jacente est qu’un employé épanoui et écouté sera plus engagé et innovant. D’un point de vue RSE, prendre soin de ses salariés est à la fois une responsabilité morale et un gage de performance durable.
Par ailleurs, la nouvelle génération de travailleurs attend des engagements concrets de la part de ses employeurs. Les jeunes talents, en particulier, n’hésitent plus à choisir leur entreprise en fonction de ses valeurs et de son impact sociétal. Cette tendance oblige les entreprises à soigner leur marque employeur en alignant leurs pratiques internes sur les valeurs qu’elles affichent. Ainsi, proposer des formations sur la diversité, garantir des procédures RH équitables (recrutement, promotions) et offrir des opportunités de développement et de participation aux décisions sont autant d’éléments qui favorisent l’engagement des collaborateurs.

Gouvernance : vers plus de transparence et d’éthique
Le troisième pilier de la RSE, la gouvernance, évolue vers davantage de transparence, d’éthique et de responsabilité. Sous la pression combinée des régulateurs, des investisseurs et de l’opinion publique, les entreprises doivent rendre des comptes plus stricts sur leur impact. En Europe notamment, de nouvelles obligations de reporting extra-financier entrent en vigueur. La directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) impose dès 2025/2026 à des milliers d’entreprises de publier des rapports détaillés sur leurs performances environnementales, sociales et de gouvernance. Ces rapports devront suivre des normes communes et inclure des informations précises (par exemple les émissions de CO₂, la consommation d’eau, la politique de diversité, la lutte contre la corruption, etc.), afin de permettre aux citoyens et investisseurs de comparer les entreprises entre elles.
L’objectif affiché est double : transparence totale sur les impacts et fiabilité des données, pour éviter le « greenwashing » et orienter les financements vers les acteurs réellement engagés.
On assiste également à un changement culturel dans la manière dont les entreprises sont dirigées. Les conseils d’administration intègrent plus fréquemment des comités dédiés au développement durable ou à l’éthique, chargés de suivre de près ces sujets et de challenger la direction sur ses progrès. La rémunération variable des dirigeants inclut de plus en plus souvent des objectifs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) aux côtés des critères financiers, afin d’aligner les incitations sur le long terme.
En 2026, on attend des entreprises qu’elles prouvent leurs engagements : fini le temps des grands discours flous, chaque allégation doit pouvoir être vérifiée.

Attentes sociétales : démontrer un impact positif et engager le dialogue
Enfin, la RSE de 2026 sera fortement guidée par les attentes de la société civile. Jamais la population n’a été aussi sensible aux questions de développement durable, d’équité et d’éthique des entreprises. Les consommateurs, en particulier, expriment clairement leur préférence pour les marques responsables. D’après une étude d’opinion, 90 % des Français disent apprécier davantage les entreprises qui ont une bonne politique RSE, et pour 88 % une telle politique renforce l’image positive d’un grand groupe. Autrement dit, le public récompense les entreprises ayant un impact positif et sanctionne celles dont les pratiques sont néfastes (pollution, scandales sociaux, etc.). Cette tendance sociétale pousse les entreprises à mesurer et valoriser leur “utilité sociale” : comment contribuent-elles concrètement au bien commun ? Par exemple, en développant des produits ou services bénéfiques (dans la santé, l’éducation, la transition énergétique…), en soutenant des causes d’intérêt général, ou en ayant des pratiques exemplaires envers leurs employés et partenaires.
Les citoyens, souvent soutenus par des ONG actives et des mouvements comme Youth for Climate, attendent aussi des entreprises qu’elles prennent position sur les grands enjeux de société. En 2026, il ne suffira plus pour une entreprise de générer du profit : il lui faudra prouver qu’elle le fait en respectant la planète et en créant de la valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. C’est l’ère de l’entreprise à mission et du “purpose driven” (entreprise guidée par une raison d’être). De plus en plus de sociétés inscrivent dans leurs statuts une raison d’être sociale ou environnementale, engageant légalement leur responsabilité sur cet objectif au-delà du seul intérêt des actionnaires.
Un autre aspect clé est le dialogue avec les parties prenantes. La RSE moderne encourage les entreprises à sortir de leur tour d’ivoire et à impliquer activement leur écosystème dans leurs décisions. Cela signifie par exemple consulter les riverains avant d’implanter une nouvelle usine, discuter avec les associations de consommateurs lors du développement d’un produit, intégrer les salariés et leurs représentants dans l’élaboration des stratégies RSE, ou coopérer avec les fournisseurs pour améliorer les pratiques tout au long de la chaîne de valeur. En 2026, cette co-construction avec les parties prenantes deviendra la norme des projets réussis. Non seulement cela permet de mieux identifier les attentes et d’éviter les conflits, mais c’est aussi un moyen d’innover et de trouver des solutions collectives aux défis complexes (changement climatique, inclusion numérique, etc.). Les entreprises qui entretiennent une relation de confiance avec leurs parties prenantes en retirent un avantage : elles gagnent en légitimité et en résilience.
À l’inverse, ignorer les préoccupations sociétales expose à des risques de boycott, de bad buzz sur les réseaux sociaux ou même de désengagement des employés.
Conclusion : des engagements à pérenniser pour l’avenir
En résumé, l’année 2026 s’annonce comme un tournant où la RSE sera plus que jamais intégrée au cœur du fonctionnement des entreprises. Les tendances majeures témoignent d’une transformation profonde du monde des affaires. L’entreprise de demain se veut responsable, transparente et engagée, parce que c’est non seulement attendu par la réglementation et les parties prenantes, mais aussi bénéfique pour sa performance globale.
Pour autant, de grands défis futurs restent ouverts au-delà de 2026. Il faudra maintenir et amplifier ces efforts dans la durée : atteindre les objectifs climatiques de 2030 puis 2050 dans un contexte d’urgence climatique croissante, inverser véritablement la perte de biodiversité, adapter les organisations aux évolutions sociales (par exemple l’essor de l’IA responsable, le vieillissement de la population active, etc.), et continuer de bâtir la confiance avec le public. La RSE est un voyage au long cours, pas une destination finale. Chaque année apporte son lot de nouveaux enjeux et de possibilités d’innovation pour un développement plus durable et équitable.
Passez à l’action : téléchargez notre guide sur comment piloter la décarbonation de son entreprise
Vous savez que la décarbonation est indispensable… mais difficile à structurer ?Ne perdez plus de temps !
Vous y découvrirez :
🔹 Les obligations réglementaires à connaître
🔹 Les étapes pour un diagnostic carbone fiable
🔹 Comment définir une stratégie de réduction réaliste
🔹 Comment bâtir un plan d’action opérationnel
🔹 Les financements mobilisables pour accélérer